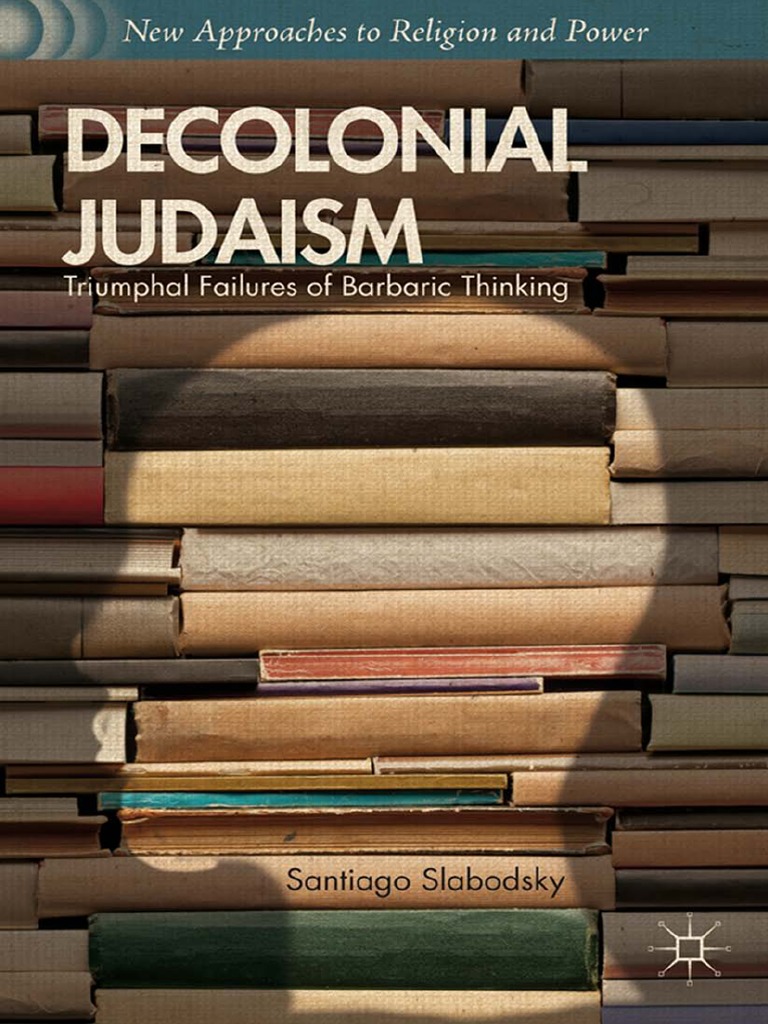Dans cette recension, Nathan revient sur les soubassements d’une pensée juive décoloniale que l’on peut retrouver chez des auteurs comme Walter Benjamin, Emmanuel Levinas ou encore Albert Memmi. À travers les concepts des études décoloniales latino-américaines, Santiago Slabodsky les confronte et en évalue la pertinence à l’aune de la reconfiguration socio-raciale de la condition juive contemporaine. D’après lui, une pensée juive décoloniale ne peut pleinement se constituer qu’à condition de partir de cette reconfiguration : telle est la thèse de l’auteur que cet article essaye de restituer.
C’est à partir de sa lecture de La statue de sel d’Albert Memmi dans lequel l’auteur se présente comme « irrémédiablement un barbare[1] » que Santiago Slabodsky initie son projet d’un judaïsme décolonial. Il y décèle une remise en cause radicale du dualisme civilisation/barbarie, au sein duquel les personnes juives ont été, selon les contextes historiques, associées à l’un des deux termes. À travers la voix d’un Juif tunisien, Slabodsky perçoit une proposition programmatique qui refuse l’assimilation et revendique la dissidence. Originaire d’Argentine, Santiago Slabodsky puise dans l’expérience des Juifs de cette région, marquée par un renversement brutal de leur positionnement socio-racial. En l’espace d’un siècle, les Juifs sont passés du statut d’ennemis de l’intérieur, considérés comme extérieurs à la nation argentine, à une intégration telle que le judaïsme constitue désormais une référence mobilisée au plus haut sommet de l’État argentin, notamment par le président d’extrême-droite Javier Milei, qui multiplie les allusions à la tradition juive pour légitimer son projet politique[2].
Dans Decolonial Judaism: Triumphal Failures of Barbaric Thinking[3], Santiago Slabodsky propose une relecture des philosophies et des littératures juives à travers le prisme de la pensée décoloniale, en particulier celle des courants hispanophones et francophones. L’essai s’attache à identifier les ressources critiques mobilisées par des auteurs dans la tradition juive ou leur propre judéité, afin de contester les fondements du projet moderne/colonial européen. Dans cette recension, je me concentrerai principalement sur l’argument central du livre, qui voit dans les perspectives juives décoloniales des contre-récits à la modernité européenne, et analyserai les tensions internes qui les traversent, notamment lorsqu’elles tendent à reproduire, malgré elles, les logiques modernes qu’elles prétendent dépasser. J’évoquerai succinctement le dernier chapitre, où l’auteur étudie comment certains discours, énoncés depuis un point de vue juif revendiqué, soutiennent l’Occident dans la lutte contre une « nouvelle barbarie ». Ces auteurs, dont les écoles de pensée s’identifiaient autrefois elles-mêmes à cette barbarie que leurs disciplines renient aujourd’hui, s’en dissocient pour mieux se démarquer, voire combattre, les autres barbares : la gauche, l’islam et le Sud global.
Sortir de la victimisation en reconsidérant la décolonialité des expériences juives (chapitres 1 et 2)
Dans le premier chapitre, l’auteur souligne la contribution limitée et fragile des études postcoloniales anglophones à la réflexion sur la condition juive passée et contemporaine. Slabodsky y pointe le paradoxe suivant : d’un côté, le Juif prototypique est reconnu comme une victime de l’antisémitisme européen qui a culminé avec le génocide. À ce titre, les Juifs sont généralement inclus parmi les peuples opprimés par la suprématie blanche. Pourtant, de l’autre côté, les efforts intellectuels et politiques juifs de résistance à cette domination sont rarement considérés et reconnus comme « décoloniaux ». Ils sont souvent relégués à de simples critiques internes à l’Europe, et non associés à des contributions à part entière à la pensée décoloniale. La souffrance juive est bien admise mais la légitimité et la portée théorique de leurs réponses à cette souffrance restent largement marginalisées dans le champ postcolonial.
Pour surmonter cette déconsidération, Slabodsky s’appuie sur les « rencontres barbares » entre penseurs juifs (Memmi, Levinas) et penseurs décoloniaux francophones (Césaire, Fanon) ou hispanophones (Mignolo, Dussel). Contrairement aux études postcoloniales, les études décoloniales latino-américaines intègrent plus volontiers ces penseurs juifs à leurs réflexions. Slabodsky souligne que tant Mignolo, dans Local Histories/Global Designs, que Dussel, dans la Philosophie de la libération, s’appuient sur la tradition hébraïque antique ainsi que sur des penseurs juifs contemporains qu’ils identifient explicitement comme juifs : Mignolo en mobilisant l’École de Francfort, et Dussel la pensée de Levinas. Les deux auteurs intègrent les Juifs parmi les autres colonisés de la périphérie, et considèrent la philosophie juive comme un levier critique de la modernité européenne depuis ses marges.
À partir de ces auteurs, Slabodsky réfléchit aux possibilités et aux limites d’une lecture décoloniale du judaïsme. L’auteur identifie trois dimensions fondamentales de l’expérience juive que l’approche décoloniale permet de mieux comprendre. La première est l’association historique des Juifs aux « barbares », au même titre que les autres racialement construits. La deuxième est la participation des littératures/résistances juives dans les études/luttes décoloniales, souvent méconnue ou soustraite. La troisième sont les résistances juives aux processus de racialisation, qui doivent être reconnues comme des propositions décoloniales.
Cependant, Slabodsky met en évidence quelques écueils qui empêchent la reconnaissance de ces perspectives juives comme pleinement décoloniales. Le premier écueil tient à la reclassification socio-raciale des Juifs dans les sociétés occidentales contemporaines où ils sont désormais, selon l’auteur, intégrés à l’Occident jusqu’à devenir des agents de l’impérialisme en Palestine. Dès lors, la possibilité qu’ils puissent formuler des critiques décoloniales semble compromise pour de nombreux chercheurs, qu’ils viennent des études juives ou postcoloniales. Le second obstacle repose sur une lecture restrictive de la souffrance juive, selon laquelle la Shoah, en tant qu’événement unique et sans équivalent, ne saurait être comparée à d’autres formes de violences raciales ou coloniales. Cette conception de l’unicité incrimine et interdit alors toute analogie théorique et politique. À l’inverse, la pensée décoloniale ne traite pas la Shoah comme un événement exceptionnel et anhistorique, mais la replace dans le continuum de la modernité européenne, jalonnée par des massacres racistes et coloniaux.
Ainsi, dans le chapitre 2, Slabodsky retrace une histoire décoloniale de l’oppression des Juifs aux côtés d’autres peuples colonisés. En effet, les discours impériaux européens ont construit une image racialisée des Juifs, en les associant à la figure du « barbare », au même titre que les Noirs, les peuples autochtones d’Amérique, les Arabes. L’auteur soutient que, dans le cadre de la modernité (de la Renaissance aux Lumières, jusqu’au colonialisme et au fascisme) les Juifs ont été intégrés à un ensemble de groupes socio-raciaux jugés inférieurs, subversifs ou irrationnels. Cette inclusion dans le registre de la barbarie ne nie pas la singularité de l’expérience juive, mais souligne au contraire les constantes dans les logiques d’exclusion. À travers l’examen de penseurs des Lumières, Slabodsky rappelle le rôle paradoxal des figures du rationalisme et de la tolérance dans la perpétuation des clichés antijuifs. Ces auteurs reconduisent des représentations antisémites anciennes qui associent les Juifs à des personnes arriérées, superstitieuses ou orgueilleuses. Cet imaginaire s’est étendu aux colonies, notamment dans les Amériques, où les Juifs furent parfois accusés d’alliance séditieuse avec des Natifs américains, ce qui a contribué à construire la figure de « l’ennemi de l’intérieur ». Au XXe siècle, Hitler, dans sa rhétorique nazie, lia l’occupation du Rhin après l’armistice de 1919 à un complot des Juifs, selon lequel ces derniers auraient non seulement trahi l’Allemagne pendant la guerre, mais aussi orchestré la présence de troupes africaines, accusées d’atteintes sexuelles, pour humilier et « souiller » la pureté de la race allemande, parmi les autres qualifications racistes que les Nazis associaient aux personnes juives (moralement dégénérées, racialement contaminées, politiquement dangereuses…). Cette idée ressurgit aujourd’hui chez les partisans de la théorie du « grand remplacement », qui attribuent fréquemment une immigration de masse fantasmée à l’influence supposée de figures juives comme George Soros. Enfin, une troisième forme d’interrelation entre les groupes racialisés repose sur l’association systématique entre Juifs et populations dites « orientales » — Arabes, Turcs, Musulmans — dans les représentations européennes. Cette corrélation repose à la fois sur des faits historiques (présence ancienne et enracinée des Juifs en terres d’islam, dans l’Empire ottoman, notamment après l’expulsion conjointe des Juifs et des Maures d’Espagne) et sur des fantasmes orientalistes. Cette assignation fut tant symbolique (la peinture ou l’iconographie représentaient les Juifs avec des turbans ou des keffiehs) que conceptuelle, comme en témoignent les propos d’Hegel ou Kant, qui parlaient des Juifs comme une « tribu arabe » ou une « race palestinienne ». Cette commune barbarisation fut ensuite intégrée dans les théories raciales et antisémites modernes, notamment par la catégorie de « sémite » qui regroupait les Juifs et les Arabes dans une même altérité culturelle, considérée comme naturellement inférieure aux Indo-Aryens européens. Si certains philosophes juifs tentèrent de subvertir cette assignation en revendiquant fièrement cet héritage oriental (comme Martin Buber), cela n’empêcha pas les discours antisémites ultérieurs de la reprendre.
La dernière critique que formule l’auteur à l’encontre des études postcoloniales concerne la manière dont elles appréhendent la position juive à travers les notions d’« hybridité » et de « tiers-espace » d’Homi Bhabha dans Les lieux de la culture : une théorie postcoloniale. Selon ce dernier, les personnes juives évolueraient dans un entre-deux, entre les deux injonctions contradictoires du pouvoir colonial : l’exclusion et l’assimilation. Le juif incarnerait un cas paradigmatique d’hybridité, ni complètement occidental, ni tout à fait étranger. Ainsi, le Juif adopterait de manière détournée la culture européenne, dans un processus créatif de négociation et d’hybridation. Historiquement exclu du centre de la modernité européenne, il est maintenant intégré dans ses dynamiques (langues, savoirs, États…). Dans les discours contemporains, le Juif est tantôt présenté comme une victime éternelle de l’antisémitisme, tantôt comme un modèle d’intégration et de méritocratie. Cette ambivalence le place dans un tiers-espace qui, selon Slabodsky, ne bénéficie pas d’une lecture politiquement critique. Le Juif, dans cette perspective, ne devient que l’illustration d’un concept (l’hybridité), sans reconnaissance de son agentivité décoloniale propre.
Ainsi, l’auteur reproche plusieurs lacunes à la notion d’hybridité, tout en reconnaissant que la notion cherche à dépasser les binarités coloniales. D’une part, elle tend à sous-estimer les asymétries de pouvoir entre les groupes en présence, ce qui risque de naturaliser les inégalités structurelles héritées du colonialisme. D’autre part, en effaçant les identités constituées, elle désarme les discours politiques de libération qui reposent justement sur une affirmation identitaire forte face à l’hégémonie. En effaçant la fracture entre dominant et dominé, l’hybridité dépolitise les luttes. Elle devient un outil herméneutique, mais pas stratégique. Enfin, elle ne rend pas compte de la complexité historique du judaïsme, notamment dans les contextes coloniaux.
Face aux limites du concept d’hybridité, l’auteur lui préfère celui de « pensée frontalière » (border thinking), élaboré par Walter Mignolo. Ce concept situe le processus d’exclusion raciale au cœur même de la modernité européenne. Contrairement aux approches anglo-saxonnes qui font commencer la modernité avec les révolutions du XVIIIe-XIXe siècles, la lecture décoloniale en situe l’origine en 1492 : année symbolique de l’expulsion des Juifs et des musulmans d’Espagne et de la conquête des Amériques. Cette modernité coloniale construit des frontières géographiques et épistémologiques à l’extérieur mais aussi à l’intérieur des empires, comme le prouve la figure du converso (à savoir, les Juifs convertis de force au christianisme ou plus généralement qui cachent leurs judéités pour survivre et s’intégrer). Ces conversos, bien que convertis, restèrent exclus et constamment persécutés, en particulier par l’Inquisition et les lois sur la « pureté du sang ». Ils incarnent cette figure du penseur frontalier, dont l’identité est imposée de l’extérieur et marquée par l’insécurité, la surveillance et la suspicion.
Contrairement à la figure de l’hybride, qui dissout les identités dans un espace de négociation, le penseur de la frontière ne cherche pas à dépasser les dualismes coloniaux, mais à y répondre d’une autre manière. Il ne peut négocier l’identité que l’empire lui impose – comme le soutient la pensée postcoloniale – alors il la réaffirme pour mieux la retourner contre lui, dans un geste de « désobéissance épistémique ». Ce processus permet l’émergence d’une lecture alternative du monde, depuis les marges. L’exemple du marrane devient alors emblématique dans le sens où il ne s’agit plus seulement d’une question théologique, mais d’une racialisation coloniale qui fait du Juif un être biologiquement « barbare », au même titre que les autres peuples colonisés. Cette dynamique s’étend aux colonies américaines et africaines, où des documents inquisitoriaux témoignent d’une réaffirmation positive d’identité juive, non pas en dépit, mais à partir des assignations impériales. Dans les colonies espagnoles, des indigènes et des Africains furent parfois accusés d’être secrètement juifs, signe d’une convergence perçue et redoutée par le pouvoir colonial. Certains conversos, à l’instar de Luis de Carjaval el Mozo, répondirent à la persécution en réaffirmant activement leur judéité. Le penseur frontalier ne cherche pas à brouiller les identités comme le ferait l’hybride, mais à s’approprier et subvertir la figure imposée du « barbare ». L’auteur conclut que, si les études décoloniales latino-américaines ne mettent pas toujours le judaïsme au centre de leurs analyses, elles offrent néanmoins un cadre très fécond pour penser l’expérience juive en relation avec d’autres formes de racisation. Il insiste sur l’importance de saisir les continuités entre les expériences coloniales, sans nier les différences. Cette approche rend possible une lecture juive de la pensée décoloniale, et réciproquement, une lecture décoloniale du judaïsme en s’appuyant sur des figures comme le marrane, dont l’expérience de la frontière constitue un espace stratégique de résistance. La pensée frontalière permet de reconnaître l’asymétrie des rapports de force, de résister à l’identité qu’on lui impose, et même parfois de se la réapproprier pour la transformer, et d’intégrer les Juifs comme acteurs du projet décolonial.
Après avoir démontré la pertinence de ce concept, Slabodsky l’illustre à travers l’analyse d’auteurs ayant écrit des « contre-récits » juifs, qui reprennent à leur compte le lexique de la « barbarie », contre la modernité européenne.
Le contre-récit des marxistes et de l’École de Francfort (chapitre 3)
Bien que Marx eût une lecture évolutionniste de l’histoire, qui va de la barbarie à la civilisation, il renverse par la suite cette perspective, en montrant que ce sont les actions du centre (l’Europe coloniale et capitaliste) qui relèvent de la barbarie. À travers ses écrits sur l’Inde, Le Capital et les Manuscrits de 1844, il développe l’idée que la soi-disant civilisation occidentale perpètre des actes d’une extrême brutalité (esclavage, exploitation, massacres) à la fois dans les colonies et en Europe même. Pour Marx, la véritable barbarie émane du centre même de la civilisation occidentale, que Rosa Luxemburg approfondira plus tard avec sa célèbre formule « socialisme ou barbarie », et que Walter Benjamin reprendra dans sa septième « thèse sur l’histoire », selon laquelle « il n’est aucun document de culture qui ne soit aussi document de barbarie[4] ». Cependant, la tradition juive marxiste ne se limite pas à proposer un contre-récit négatif de la barbarie selon lequel elle serait avant tout le produit du capitalisme et du colonialisme européen. Elle élabore aussi un contre-récit positif, qui part du judaïsme pour critiquer la modernité européenne. Lorsque Benjamin invite à lire « l’histoire à rebrousse-poil », il appelle à reconnaitre les expériences que le récit moderne a subsumées ou marginalisées. Ainsi, contre l’idée de progrès, il affirme une autre temporalité qu’il puise dans le messianisme juif (où l’instant présent devient le moment privilégié pour agir, transformer et « réparer » le monde, afin de préparer et rendre possible l’ère messianique, qui correspond à un monde de justice et de paix dans la tradition juive, plutôt que de l’attendre passivement).
De leur côté, Horkheimer et Adorno cherchent aussi dans le judaïsme ce que la modernité considère comme une altérité inassimilable à éradiquer pour critiquer cette même modernité. Dans La Dialectique de la Raison, Horkheimer et Adorno examinent la face sombre de la modernité et de l’Aufklärung (les Lumières), en montrant que le projet d’émancipation rationnelle s’est paradoxalement transformé en un instrument de domination et de barbarie. Si les Lumières promettaient la libération de l’humanité par la raison, elles ont, selon eux, produit un système qui réduit toute chose à l’utile, à l’appropriable, en excluant ce qui ne peut être mesuré ou assimilé. La philosophie des Lumières, en cherchant à identifier et maîtriser absolument tout par le langage ou la raison, se mythifie elle-même. Ainsi, les deux Francfortois décèlent dans la religion juive un « espoir » face à la tendance autodestructrice de la Raison, notamment dans « l’interdiction de donner le nom de Dieu à ce qui n’est pas lui, de donner au fini le nom d’infini, et au mensonge celui de vérité[5] ». Cet interdit de prononcer le nom de Dieu est l’expression d’une épistémologie critique du réel, pour qui le savoir n’est ni absolu ni définitif, et qu’il doit toujours être remis en question. Pour Santiago Slabodsky, loin d’être un simple principe théologique, cet interdit exprime une éthique du non-savoir et de l’humilité, qui reconnait l’altérité irréductible que les régimes totalitaires cherchent précisément à dominer. Dès lors, l’interdit de prononcer le théonyme ne constitue pas uniquement une barrière symbolique, mais un geste critique et décolonial, qui propose une alternative à la violence légitimée par les discours de maîtrise et d’absolu de la raison européenne.
Le contre-récit d’Emmanuel Levinas (chapitre 4)
Le deuxième contre-récit repose sur la critique lévinassienne de l’ontologie occidentale, dont la logique est de ramener systématiquement l’Autre au Même. Cette démarche est une première tentative d’inciter la philosophie européenne à considérer l’altérité, dans son irréductibilité, qu’elle a eu tendance jusqu’alors à subsumer ou assimiler. Cependant, l’altérité radicale, à laquelle se réfère Levinas pour développer sa critique de la philosophie européenne, se résume au seul horizon du judaïsme européen, ce qui exclut ainsi les expériences coloniales non-européennes.
Mais à partir des années 70 et 80, durant lesquelles Dussel rencontre Levinas et l’influence de ce dernier sur sa pensée devient manifeste, Levinas commence à prendre ses distances avec son eurocentrisme. Dans une page d’Autrement qu’être (1974), il affirme qu’une philosophie soucieuse de l’autre en tant qu’autre n’est possible « sans introduire quelques barbarismes dans la langue »[6]. Il faut ici lire le terme « barbarisme » dans son sens étymologique, comme ce que la pensée grecque ne comprend pas. Autrement dit, Levinas encourage à partir des traditions de pensée étrangères à la philosophie européenne. Cette orientation se retrouve au fondement de la philosophie de la libération d’Enrique Dussel. Quant à lui, Levinas s’ouvre aux autres peuples colonisés partir d’une lecture géopolitique du Talmud. Dans À l’heure des nations, Levinas étudie Pesahim 118b, et trace une cartographie morale et politique dans laquelle deux types de communautés s’opposent : d’un côté, Rome (paradigme de l’empire prédateur et de l’accumulation capitaliste) que Levinas associe à l’Europe et aux États-Unis, de l’autre, une coalition éthique composée d’Israël, de l’Égypte et de l’Éthiopie, qu’il associe, de manière scabreuse, au Tiers-Monde. Il légitime même cette alliance en recourant à un commentaire de Rashi[7] selon lequel l’Égypte et l’Éthiopie feraient partie de la communauté d’Israël. Ce geste n’est cependant pas exempt d’ambiguïtés. D’une part, en associant symboliquement Israël, Égypte et Éthiopie, il construit une communauté des opprimés qui cherche à dépasser les normes européennes. D’autre part, en subsumant les autres colonisés (l’Égypte et l’Éthiopie) à l’expérience juive (Israël), Levinas court le risque d’instrumentaliser ces figures (Égypte, Éthiopie) pour servir un projet éthique juif, ce qui pourrait reconduire un certain judéo-centrisme. Ainsi, ce commentaire talmudique fonctionne, à la fois, comme une dénonciation des structures de domination contemporaines, mais aussi comme une tentative d’extraire le judaïsme de sa réduction à l’Occident post-Holocauste. Pour Levinas, Israël ne doit pas être un État-nation traditionnel, mais l’espace idéal dans lequel peuvent s’effectuer les lois et la justice divine dans l’histoire. Levinas se réfère ici à des commandements bibliques, qui par exemple prescrivent l’accueil de l’étranger et interdisent l’exploitation de son prochain (Lévitique 19).
Cependant, Slabodsky souligne le paradoxe de cette démarche qui, d’un côté, envisage Israël comme un idéal prescriptif et, de l’autre, dans la mesure où Levinas associe, dans ses interprétations talmudiques, l’Empire romain à l’Occident, il est donc légitime de penser que son Israël fait également référence à une réalité contemporaine. Ainsi, Levinas intègre Israël dans sa communauté des exilés et des opprimés sans prendre en compte que cette même communauté le juge, à raison, comme un État colonial et occidental. Levinas semble donc négliger la nouvelle condition politique des Juifs dans cette région dominée par Israël, qui ne renvoie plus à la libération biblique mais à la domination sioniste.
Le contre-récit d’Albert Memmi (chapitre 5)
Le troisième contre-récit est celui d’Albert Memmi, qui, dans une démarche proche de celle d’Aimé Césaire dans Cahier d’un retour au pays natal, réinvestit l’image du barbare de manière positive. Pour lui, cette figure devient un symbole de résistance culturelle face à la colonisation et à l’assimilation. Dans son autofiction, La Statue de sel, Memmi mobilise l’isotopie de la barbarie pour décrire ses coutumes et traditions juives, qu’il défend contre l’universalisme civilisateur du colonialisme européen. Ce geste littéraire initial se transforme rapidement en projet politique. En effet, Memmi radicalise sa pensée autour de la figure du barbare, qu’il érige en principe d’émancipation juive hors du cadre normatif occidental. Refusant toute tentative d’assimilation, il affirme que la seule voie de sortie pour les Juifs opprimés passe par une acceptation de soi profondément politique, qui refuse le regard européen qui hiérarchise les civilisations, et une alliance avec les autres peuples opprimés du Sud global. Dans son second roman autofictionnel, Agar, Memmi met en scène son expérience du couple mixte avec une Française catholique. Il est profondément surpris lorsque sa compagne, au détour d’une discussion sur leur mariage à l’occasion d’une visite chez un rabbin, le qualifie de « crasseux », révélant ainsi son racisme. Humilié, le narrateur oppose alors les défauts des siens à l’arrogance « des gens du Nord », incarnés par sa compagne. À ce moment, loin de rejeter l’étiquette de barbare, il l’embrasse pleinement et affirme sa solidarité avec les autres peuples colonisés (Juifs, Arabes, Noirs, Chinois…) dont il assume symboliquement la responsabilité. À travers cette scène, Memmi revendique son appartenance au Sud global et appelle à une solidarité anticoloniale entre tous ceux que l’Occident désigne comme barbares. Ainsi, dans cette perspective, Albert Memmi estime que la décolonisation des Juifs ne peut être effective seulement dans le sionisme, qu’il associe aux autres libérations nationales des peuples colonisés. Ce n’est que dans le sionisme que les Juifs pourraient prendre en main leur destin dans une libération nationale, qui garantirait leur sécurité, leur dignité et leur culture sans qu’elles soient aliénées.
Ainsi, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, plusieurs penseurs juifs, parmi lesquels Emmanuel Levinas et Albert Memmi, ont contribué à élaborer une pensée juive décoloniale. En réinvestissant positivement la figure du barbare, ils ont tenté de formuler des contre-récits, situés depuis leurs judéités. Dans cette perspective, le sionisme était considéré comme l’opération par laquelle les personnes juives pouvaient réaffirmer leurs judéités authentiquement et indépendamment des normes modernes et européennes. Cependant, cette tentative de réhabilitation se heurte à une contradiction majeure : l’État d’Israël, tel qu’il se constitue à partir du projet sioniste, reproduit à la fois dans son idéologie et dans ses pratiques les logiques coloniales mêmes que ces intellectuels prétendaient contester.
Par ailleurs, dans le chapitre 6, Santiago Slabodsky rappelle, par un détour aux ouvrages d’Edward Said, notamment La question de la Palestine – et plus précisément le chapitre intitulé « Le sionisme du point de vue de ses victimes » – ainsi que par les travaux d’Ella Shohat, Le sionisme du point de vue de ses victimes juives, tous deux publiés cinq ans avant À l’heure des nations d’Emmanuel Levinas, que le sionisme n’est en aucun cas un projet « barbare », mais qu’il est à la fois européen et colonial, tant en théorie qu’en pratique. D’une part, parce que le sionisme se présente comme « l’avant-poste de la civilisation contre la barbarie[8] », selon l’expression de Theodore Herzl, de l’autre parce qu’il s’agit d’un mouvement historiquement initié par la bourgeoisie juive assimilée d’Europe centrale, dont le modèle était profondément européen et moderne. De plus, les premiers sionistes manifestaient un profond mépris à l’égard des Juifs non européens, une attitude qui s’est prolongée au-delà de la fondation de l’État d’Israël et qu’Ella Shohat a largement documentée. Enfin, le sionisme continue de prospérer sur l’expulsion, la dépossession et l’oppression des Palestiniens.
Ainsi, deux postures interprétatives peuvent dès lors être envisagées face à cette tension.
La première prend acte de cette contradiction comme élément structurant de leur pensée et cherche à en analyser les causes dans leur contexte intellectuel. Emmanuel Levinas et Albert Memmi écrivaient dans un Paris intellectuellement dominé par la figure de Jean-Paul Sartre. Ce dernier, qui a d’ailleurs rédigé la préface du Portrait du colonisé de Memmi, incarne un engagement à la fois anticolonial et résolument favorable à Israël. Levinas et Memmi s’inscrivent ainsi dans un moment historique où l’engagement anticolonial et prosioniste était encore cohérent, voire hégémonique dans certains cercles intellectuels. Toutefois, à la différence de Sartre, qui n’associait pas les Juifs aux barbares, Levinas et Memmi revendiquaient cette altérité critique de la modernité occidentale. Cette réappropriation de la barbarie demeure contradictoire dès lors qu’elle s’opère au sein du projet sioniste. Bien que le contexte intellectuel permette de comprendre en partie cette contradiction, il ne saurait en dissiper les apories, au premier rang desquelles figure l’incapacité de nos deux auteurs à reconnaitre et à intégrer les Palestiniens dans leurs réflexions. Dès lors, l’affirmation de la judéité dans une perspective décoloniale ne peut être dissociée de son instrumentalisation dans un cadre nationaliste et colonial, ce qui en limite profondément la portée critique. Il est donc nécessaire de reconnaitre ces apories et d’en expliquer les causes structurelles.
Sladobdsky mobilise à nouveau la pensée décoloniale pour résoudre ce problème, en s’appuyant notamment sur le projet transmoderne d’Enrique Dussel, qu’il décompose en trois étapes : la revalorisation des cultures marginalisées ou subsumées par la modernité européenne, la critique interne de ces mêmes cultures pour prévenir l’essentialisme, et enfin, le dialogue et la solidarité entre les autres peuples opprimés. Levinas et Memmi accomplissent la première étape en réaffirmant leurs judéités, en rupture avec l’imaginaire européen dominant.
Mais leur projet échoue à atteindre la deuxième étape dans la mesure où aucun des deux ne parvient à questionner leur nouvelle condition socio-raciale ni à identifier les dérives ethnocentriques auxquelles leurs philosophies respectives s’exposent. Par exemple, Levinas mobilise dans ses prises de position sur Israël un commentaire talmudique médiéval élaboré dans un contexte de persécution, sans interroger les discontinuités historiques entre cette époque et le présent israélo-palestinien. Ce recours à des sources perçues comme anhistorique empêche toute mise en question du repositionnement socio-racial des personnes juives, autrement dit, de son passage d’une position subalterne à une position dominante en Palestine. De son côté, Memmi conçoit le peuple juif comme porteur d’une identité « irrémédiablement barbare » qui trouverait sa réalisation authentique dans l’État-nation israélien. Mais ce dernier se prétendant comme « l’avant-poste de la civilisation contre la barbarie » entre en contradiction avec les velléités barbares de l’auteur. La difficulté majeure ne réside donc pas seulement dans leur rapport problématique au sionisme, mais dans leur incapacité à réinterpréter leur tradition de manière critique et contextuelle. En définitive, c’est l’usage anachronique et essentialisant de la judéité qui constitue l’obstacle principal à la cohérence de leur projet. En cherchant à affirmer une barbarie juive à l’Occident, tout en l’arrimant à un État-nation colonial et occidental, ils reconduisent la logique qu’ils voulaient initialement subvertir.
L’émergence d’une réaction philosémite
Dans le dernier chapitre, Santiago Slabodsky ne s’intéresse plus aux philosophes juifs qui ont réfléchi à la barbarie en l’associant aux crimes du capitalisme européen (Benjamin, Adorno & Horkheimer) ou en la réinvestissant comme position critique (Levinas, Memmi), mais à ces intellectuels d’État, comme Robert Kaplan ou Bernard-Henri Lévy, qui ont adopté ce qu’il appelle « la nouvelle reclassification du judaïsme[9] ». Ces auteurs assimilent désormais la barbarie non plus à la modernité européenne, mais aux « nouveaux antisémites » : la gauche, l’islam et le Sud global. D’après Slabodsky, l’influence et la popularité de ces nouveaux intellectuels juifs s’expliquent par « le changement dans la configuration raciale qui attend désormais des Juifs qu’ils soient parmi les porte-paroles nécessaires d’une perspective géopolitique qui, par la force des choses, mobilise le récit de la barbarie[10] ». En rappelant le néo-racisme de cette théorie, qui attribue les inégalités de développement à des facteurs culturels et moraux plutôt qu’à des causes socio-économiques, Slabodsky s’attarde surtout à l’originalité de cette théorie, qui insiste sur l’enjeu quasi existentiel pour les sociétés occidentales à protéger les personnes juives, dont les intérêts sont considérés comme alignés avec ceux de l’Occident.
Slabodsky s’intéresse à la manière dont cette théorie se construit à partir d’une perspective à la fois occidentale et explicitement juive. Kaplan place le peuple juif au cœur des discours et des politiques de la « guerre contre le terrorisme », selon lesquels la défense de l’État d’Israël représente un enjeu civilisationnel. Dès lors, l’État israélien incarne la supériorité de la civilisation au milieu d’un Moyen-Orient instable, tandis que les Palestiniens, les musulmans et les peuples du Sud sont décrits comme irrationnels, violents et réactionnaires. Le peuple juif devient alors le modèle par lequel est pensé l’intégration à la modernité mais surtout son garant. Ce raisonnement réactive un discours colonial inversé selon lequel le Juif n’est plus l’autre arriéré et inassimilable de la civilisation européenne, il devient désormais le modèle, le protégé et la sentinelle de « la civilisation judéo-chrétienne » contre la barbarie des populations postcoloniales. Slabodsky étend aussi son analyse à Ce grand cadavre à la renverse, publié deux ans après les émeutes de 2005 que Bernard-Henri Lévy qualifie de « barbarie », dans lequel l’intellectuel médiatique prend la défense de l’Europe et des États-Unis contre cette « nouvelle barbarie ». Dans les pas de Robert Kaplan, BHL, « va cependant un cran plus loin. Selon lui, non seulement toute attaque contre Israël ou les Juifs est ipso facto une attaque contre l’Occident, mais toute attaque contre l’Occident peut également être interprétée comme une attaque antisémite contre les Juifs[11] ». Pour BHL, « l’antiaméricanisme est une métaphore de l’antisémitisme[12] », par laquelle toute critique des États-Unis ou de l’impérialisme américain fonctionnerait comme des dog whistle ou des messages codés dont le sens implicite serait compris par les antisémites comme une allusion aux « Juifs » ou à une « puissance, domination, conspiration juive ». Ainsi, cette rhétorique philosémite consiste à protéger l’Occident sous prétexte de défendre les Juifs, et à défendre les Juifs au nom de la protection de l’Occident.
En résumé, ce livre pose les premiers jalons d’une réflexion nouvelle sur la judéité à partir d’une approche décoloniale. Il essaye de répondre à cette question : « Si les personnes juives ont effectivement subi une reclassification raciale [passant des marges à une intégration précaire à la blanchité jusqu’à en devenir l’avant-poste en Palestine], peuvent-elles encore représenter un défi pour la même structure qui les accueille désormais ? En d’autres termes, les Juifs peuvent-ils encore être une source convaincante de propositions décoloniales ?[13] »
Nathan PATRON-ATLAN
[1] MEMMI, Albert. La Statue de sel. Paris : Gallimard, coll. Folio, 1985, p.184
[2] TANK-STORPER, Sébastien. Les Juifs d’Argentine : une histoire de justice. Paris : Calmann-Lévy, 2025
[3] SLABODSKY Santiago, Decolonial Judaism: Triumphal Failures of Barbaric Thinking, New York : Palgrave Macmillan, 2014
[4] LÖWY, Michael. Walter Benjamin : avertissement d’incendie – Une lecture des Thèses sur le concept d’histoire. Paris : Éditions de l’éclat, coll. Philosophie imaginaire, 2018, p. 66
[5] HORKHEIMER, Max, ADORNO, Theodor W. La dialectique de la raison : fragments philosophiques Traduit de l’allemand par Éliane KaufholzParis : Gallimard, 1983, Collection « Tel », p.40
[6] LEVINAS, Emmanuel. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. Paris : Le Livre de Poche, 22 novembre 1990, coll. « Philosophie », p.273
[7] Grand rabbin français médiéval (1040‑1105)
[8] HERZL, Theodor. L’Etat juif (traduction de M. Lipschutz), Paris, Éditions de la Revue Blanche, 1926, Wikisource, p. 95
[9] SLABODSKY, Santiago. Decolonial Judaism: Triumphal Failures of Barbaric Thinking. New Approaches to Religion and Power. New York: Palgrave Macmillan, 2014, p.185 (ma traduction)
[10] Ibid., p.180
[11] Ibid., pp.185-186
[12] LEVY, Bernard-Henri, « L’Autre socialisme des imbéciles », in Ce grand cadavre à la renverse, Paris, Grasset, 2007
[13] SLABODSKY, Santiago. op. cit., p.30 (ma traduction)